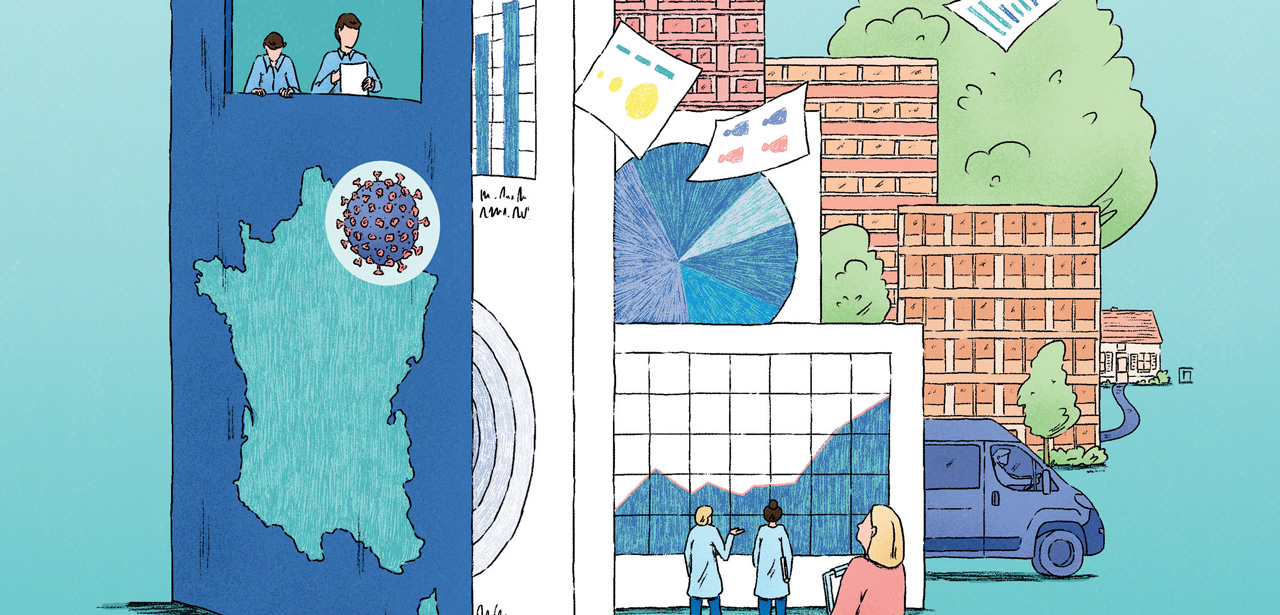Points clés
La légionellose est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire (MDO) depuis 1987 en raison de sa gravité et de la possibilité d’agir sur les sources d’exposition et de limiter ainsi sa diffusion. Totalisant sur la période 2017-2021 près de 320 cas en moyenne chaque année, soit 18% des cas nationaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée par cette pathologie.
Ce BSP présente le système de surveillance et le rôle des acteurs, en particulier les interventions de l’ARS suite à la déclaration d’un cas de légionellose en lien avec la réglementation applicable présentée ici de manière très synthétique. Pour décrire la situation épidémiologique et les sources d’exposition potentielles, en plus des données issues de la surveillance des MDO habituellement utilisées, ce BSP s’appuie sur les données de la surveillance cartographique mise en place dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Après une montée en charge du système de surveillance jusqu’au début des années 2000, le taux d’incidence de la légionellose était relativement stable jusqu’à ces dernières années où il est constaté une tendance à l’augmentation, les années 2018 et 2021 constituant d’ailleurs des années records aussi bien dans la région qu’au niveau national. Les disparités géographiques d’incidence sont importantes avec un gradient Ouest-Est observé au niveau national ainsi qu’à l’échelon régional avec des taux particulièrement élevés dans les départements alpins de notre région.
Si le climat et ses évolutions semblent indéniablement jouer un rôle dans ces disparités géographiques et cette augmentation récente, d’autres hypothèses impliquant d’autres facteurs environnementaux (paramètres physico-chimiques de l’eau distribuée, qualité de l’air, nouvelles sources de contamination et/ou évolution des sources déjà connues, …), des facteurs populationnels (vulnérabilités au sein de la population) ou encore liés au système de surveillance (exhaustivité de la DO, évolution de l’utilisation des tests de diagnostic) peuvent y contribuer et restent à explorer.
Globalement satisfaisante, l’exhaustivité de la déclaration obligatoire (DO) dans la région, réévaluée sur la période 2010-2020, a montré qu’elle a augmenté, atteignant 87 % en 2020. Cependant, elle n’est pas homogène sur tout le territoire, variant de 70% à 93% selon les départements, ce qui permet d’envisager des actions de sensibilisation ciblées.
Les caractéristiques épidémiologiques des cas évoluent peu dans le temps et ne diffèrent pas de celles des autres régions hormis la létalité observée en Auvergne-Rhône-Alpes qui est inférieure à la moyenne nationale depuis plusieurs années, témoin d'une bonne sensibilisation au diagnostic précoce et d’une bonne prise en charge par les professionnels de santé. La maladie touche majoritairement les hommes, l’âge médian des cas déclarés est de 65 ans et le tabac reste le facteur favorisant le plus souvent identifié.
L'antigénurie reste majoritairement le diagnostic de première intention mais l’utilisation de la PCR progresse et permet de détecter plus fréquemment des Legionella non Lp1, toutefois très minoritaires. Une souche clinique a été isolée pour 26% des cas en Auvergne-Rhône-Alpes (2017-2021) avec des disparités départementales importantes. Il est important de rappeler aux professionnels de santé l'intérêt des prélèvements respiratoires bas pour la mise en culture. L’isolement de souches permet de caractériser les souches circulantes dans la région et lorsque des souches environnementales sont disponibles, de confirmer la source de contamination par comparaison, ce qui a été possible pour 30 cas déclarés sur la période 2017-2021.
Pour la grande majorité des cas déclarés (73 %), aucun lieu à risque en dehors du domicile n’est identifié, ce qui laisse suspecter le rôle prépondérant du domicile dans la survenue des cas isolés qui constituent aujourd’hui la grande majorité des situations. La notion de voyage (hôtel, gite, camping, résidence temporaire) est l’exposition à risque la plus fréquente chez les cas pour lesquels des lieux à risque sont rapportés. Ces résultats sont concordants avec quelques sources d’exposition qui ont pu être précisées grâce à la comparaison des souches humaines et environnementales réalisées par le CNR-L. Certaines expositions à risque qui tendent à se développer comme les jacuzzi, ont fait l’objet d’une réglementation récente qui devrait permettre de limiter les risques.
Au total, si les données rassemblées dans ce BSP témoignent des progrès réalisés dans la surveillance, la prise en charge médicale, la gestion et la prévention du risque légionnelle dans la région, l’évolution de l’incidence de la maladie reste préoccupante et justifie de poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé à la DO et à l’intérêt des prélèvements respiratoires profonds. Il met également l’accent sur le besoin d’améliorer les connaissances sur les facteurs et/ou sources d’exposition environnementales non identifiés, la majorité des zones localisées de sur-incidence restant à ce jour inexpliquée.